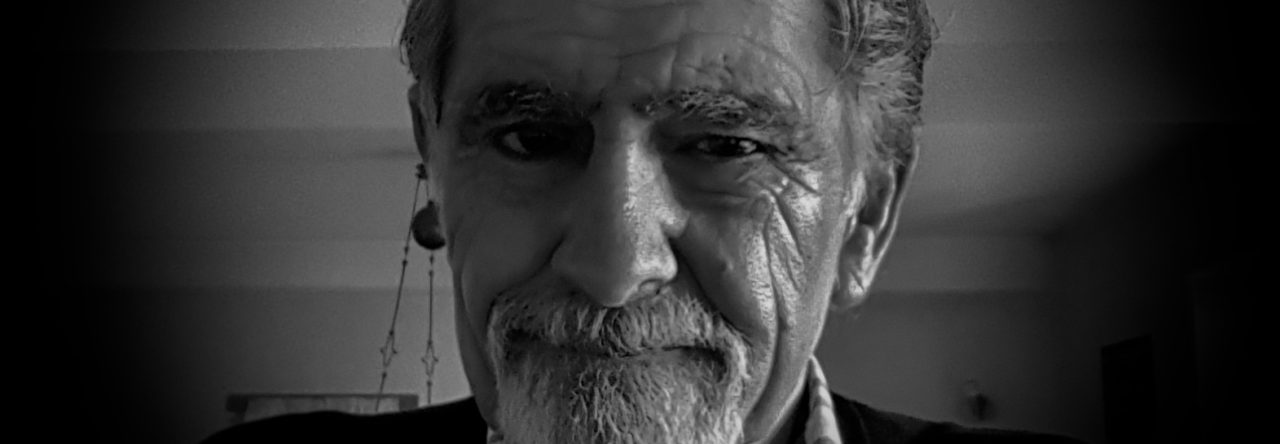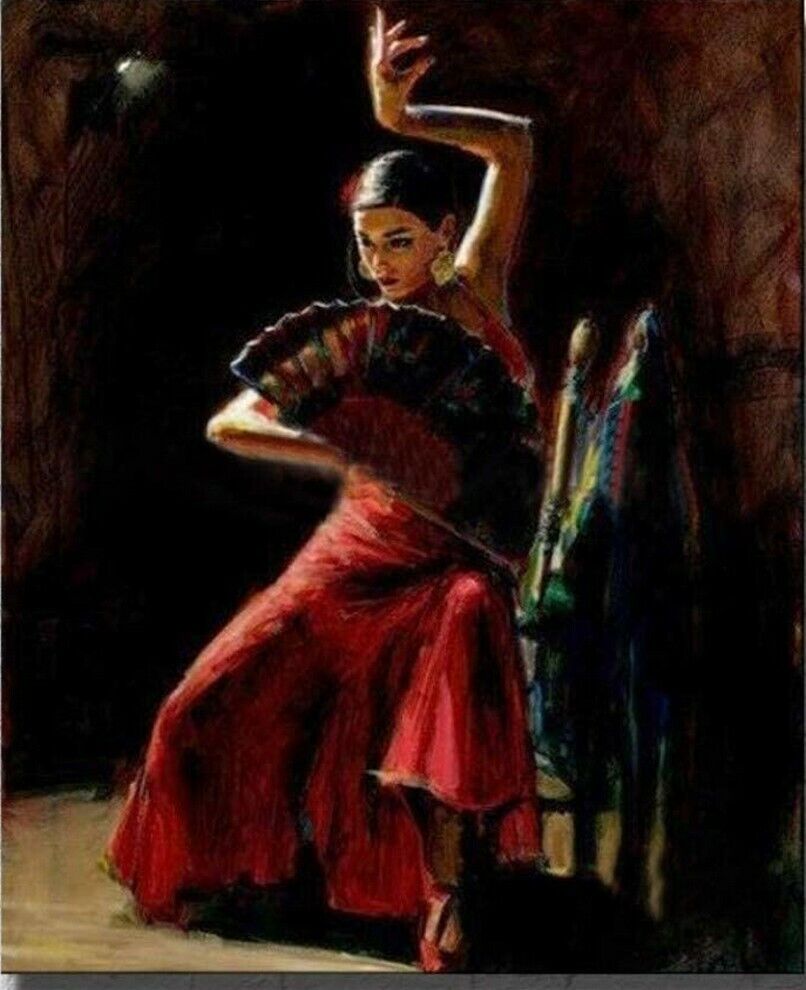Bien au delà du tout là-bas, vous savez bien, tout-tout-tout-là-bas, presque aux confins du bout du monde, au milieu d’un petit village niché dans ce que l’on appelait jadis le Bas Dauphiné, parfaitement bien implanté devant le jeu de boules ; (vous savez bien, là où il y a des platanes centenaires, qui, boudiou de boudiou, s’ils pouvaient parler, et bien pour sûr, le Sud de la France serait le plus grand théâtre comique gaulois du monde !…) ; donc, tout-tout-tout-là-bas, à la limite de la plaine et des montagnes alpines, sous l’ombre bienveillante des platanes muets, la terrasse du tripot communal »Chez Momo » déborde de monde.
Et pour cause ! Ce jour, mesdames et messieurs, c’est l’événement attendu par tous sans exception ! Comment, vous n’étiez pas au courant ? Si je puis vous donner un conseil, au lieu de vous abonner aux TikTok, Instagram et compagnie, je serais vous, je souscrirais un abonnement au CUD, le réseau téléphonique des Cancans Ubuesques du Dauphiné, truchement de tout ce qui est folklorique par là-bas, au fin fond du Bas Dauphiné. Ainsi, vous seriez au courant du concours de boules de pétanque du siècle qui oppose deux équipes explosives.
Il y a ceux du haut du village, les Grandes-Gueules forts en verbe ; et, les autres du bas du village, les Bravaches, peuchère, plus fanfaron qu’eux, tu meurs ! Le match s’annonce pittoresque et haut en couleurs verbales. Pensez donc, il y a là, le Paulo d’en haut, célèbre pour son tir de pointe d’une précision diabolique, et, en opposé, le Marcel d’en bas, qui n’a pas son pareil pour tirer et faire sauter les boules du Paulo. La bataille doit se dérouler en six parties. La victoire sera attribuée à l’équipe qui totalisera cinq parties gagnées sur six, ce qui est quasiment impossible. En cas de non victoire, on remettra ça l’année prochaine. Et, tenez-vous bien, cela fait vingt cinq ans que cette comédie burlesque perdure, avec une seule victoire des Bravaches du bas du village.
Tout est prêt. Le soleil, maître incontesté de la fête, a bien voulu participer à l’événement. Le terrain vient d’être ratissé, ne laissant aucun minuscule caillou se pavaner sur le sable. Aux deux extrémités, solidement amarrées, des traverses de chemin de fer délimitent parfaitement la surface de jeu, tandis que des bancs, installés sur les côtés du terrain, s’apprêtent à supporter la fureur des spectateurs. Et, pour achever ce tableau jouissif, goguenards à foison, les joueurs se lancent des défis, à qui mettra une fanny à l’autre. Oui, tout est prêt, enfin non, pas tout à fait. Il ne manque plus qu’au curé du village d’effectuer le tirage au sort. Pourquoi le curé ? Parce que, pour éviter tous palabres, il est bien le seul arbitre dont personne n’oserait contester le jugement. Et, tenez-vous bien, ce sont les épouses des joueurs qui l’ont imposé à leurs braillards de maris ! «C’est bien, ça leur clou le bec. Et puis, ils s’abstiennent de jurer comme des charretiers en présence du curé», explique en riant la Simone du bas du village, copine comme pas deux avec la Jeannette de haut du village.
Le tirage au sort ayant désigné les Grandes-Gueules, le Paulo lance le cochonnet, et, déjà, il y a réclamation ! D’après les Bravaches, il est jeté à plus de 20 mètres, ce qui est interdit par le règlement. Après vérification, il est à 19,80 mètres, uniquement pour que le Marcel d’en bas rate ses tirs ! «A cette distance, le Marcel peut se rhabiller, il n’est pas prêt de le réussir son fameux carreau-tiré, commente le Grégoire des Grandes-Gueules, il pourra juste faire peur aux mouches». Et là, après avoir fait son cinéma de pointeur, sans oublier de s’essuyer les mains avec son chiffon porte-bonheur, ni de dire aux Bravaches qu’ils vont assister à un pointage de fou qui va les tuer net, le Paulo lance sa boule, et, boudiou de boudiou, la place à un demi centimètre du cochonnet ! Du grand art, de quoi tétaniser les pointeurs concurrents.
Toute la populace s’esclaffe devant un tel exploit, quand, toute essoufflée, la vieille bigote du haut du village ; (vous savez bien, dans tous les villages de France et de Navarre, il y a toujours une vieille colporteuse de ragots) ; donc, la vieille Émilie ou Félicie, à moins que ce soit la vieille Antonine, peu importe, arrive toute essoufflée et crie : «Le Germain, c’est-y pas croyable…» – «Bien quoi, lui demande le maire du village ?» – «Oui, qu’est-ce qui lui arrive au vieux Germain, renchérit le curé ?» S’ensuivit un flot de questions de la populace, pressant de questions la pauvre vieille qui ne parvient pas à reprendre son souffle. «Allons, Séraphine, demande le maire, dites-nous ce qu’il lui arrive à l’ancien». La vieille demoiselle les regarda tous, les uns après les autres, et s’exclama : «Le vieux grippe-sou s’en est trépassé, et, par Saint Michel, c’est-y pas une bonne affaire que ce décès ?» S’en suivit tout un tas de commentaires, de palabres plus ou moins insolites, au sein desquels plusieurs mots sortaient du lot : souterrain – puits – vieux fou – échelle scellée – porte en fer – trésor – vieux radin – château – maintenant, on va peut-être savoir – ça dépend de qui va hériter…
- Et, vous, Monsieur, qu’en pensez-vous de cette histoire de souterrain, me demanda le maire ?
*****
J’étais arrivé dans ce village la veille au soir, mandaté par le fabricant d’un moteur industriel pour résoudre un litige entre la mairie et l’installateur du dit moteur. Ayant passé la nuit dans l’auberge familiale du coin tenue par le maire et son épouse ; (vous savez bien, ces tavernes du siècle dernier, aux charmes désuets, avec le patron aux fourneaux, mais aussi de passage régulièrement au bar, vantant son eau de vie de poire ; sans oublier la patronne œil-de-lynx derrière la caisse enregistreuse, et une jolie fille du coin pour faire le service et aider à faire le ménage dans les chambres) ; je m’apprêtais à repartir le lendemain en fin de matinée, quand le maire m’invita à rester à cette partie de pétanque historique, tout en m’offrant la nuitée suivante en remerciement d’avoir solutionné ce conflit qui durait depuis des mois. Nous étions un vendredi, la partie avait lieu en fin d’après-midi, et, je n’avais rien de prévu pour le week-end. Trouvant là un bon prétexte pour passer une bonne soirée et visiter la région le lendemain, j’acceptais. Eh ! Mettez-vous à ma place, une partie de pétanque savoureuse à souhait, suivie par une vadrouille touristique, il faudrait être fou pour laisser passer de pareilles opportunités !
Lui ayant dit que je n’avais pas trop compris ce qui se passait, il me raconta une histoire locale basée sur les succulents ont-dits qui alimentent les cancans campagnards.
*****
Tout à commencé en 1790, où les biens des nobles et des ecclésiastiques furent nationalisés et vendus par lots aux gens du cru. Ainsi, une ferme de ce village, jadis dépendante d’un château-fort en ruine, fut achetée par un ancêtre du dénommé Germain. La particularité de cette exploitation agricole, hormis des bâtiments en pierre de taille, était ses deux puits situés à une dizaine de mètres l’un de l’autre.
L’un était d’une petite circonférence avec une profondeur de douze mètres, équipé d’une pompe à main qui fonctionnait toujours. Le second mesurait 2,80 mètres de diamètre, fortement verrouillé par un ensemble de tôles et de ferrures, descendait à plus de vingt sept mètres sous terre ! Enfin, c’est ce qui se disait dans le pays, car, de mémoire d’homme, personne n’était descendu dans ce gouffre. Par contre, des vieux racontaient que leurs grand-pères leur avaient dit que leurs aïeux prétendaient que dans ce puits, il y avait des barreaux d’acier fixés dans le mur, comme une échelle, et qu’à huit ou dix mètres de profondeur, peut-être plus, il y avait un recoin taillé dans le roc, devant lequel était scellée une porte de fer. Et, depuis la nuit des temps, la populace parlait d’un souterrain reliant le château à la ferme, mais aussi de mystérieux cadavres dans ce puits.
Là, je vous vois venir, avec la même réflexion que j’avais faite au maire : «Mais, pourquoi, depuis tout ce temps, personne n’a jamais ouvert ce puits ?» Tout simplement parce que tous les membres de la famille Germain avaient toujours refusé de l’ouvrir en prétextant : «Il ne faut pas réveiller les morts». De quoi alimenter les rumeurs les plus folles. Que cachait ce puits, et que dissimulaient les Germain depuis des lustres ? Mais, là, avec le décès du vieux Germain, on allait enfin savoir, car, il n’avait pas d’héritier, et la mairie désirait acheter le terrain du puits pour construire un stade.
*****
Un an après, toujours en fin de semaine, en revenant de mission du côté de Gap, je prenais le chemin des écoliers pour rentrer chez moi, quand j’aperçus un panneau indiquant le nom de ce petit village. Vingt minutes plus tard, je retrouvais le maire dans son auberge familiale. Heureux de me revoir, il m’expliqua toute l’histoire «La mairie avait hérité de tous les biens du vieux Germain, à deux conditions : que le puits soit ouvert, visité, de façon à ce que ce mystère soit éclairci. Une fois cela réalisé, la mairie devrait impérativement le combler pour que les cadavres, si il yen avait, puissent dormir en paix».
On ouvrit le puits, vide d’eau, et qui, finalement ne mesurait que cinq mètres de profond, et, ne possédait aucun barreau d’acier scellé dans le mur. Au fond, on trouva la cavité fermée par une porte de fer. Derrière cette poterne, une salle d’environ six mètres carrés. Fixées sur les murs, des chaînes laissaient entrevoir que des gens avaient été prisonniers ici, mais, aucun cadavre. Le maire fit faire des recherches historiques qui aboutirent à ceci : «Au quatorzième siècle, le Registre des Feux de cette région, qui recensait les habitants des villages, fait état d’une tour prison avec deux gardes, la dite tour dépendait du château du village. En 1626, sur ordre de Richelieu, deux mille châteaux furent détruits en France, ce qui fut le cas de celui de ce village». Ainsi, ce puits n’était que la base d’une tour prison possédant une oubliette sordide. Aucun souterrain, ni trésor, ni cadavre… Des photos furent prises, le puits fut comblé. Quant à la réflexion des Germain concernant le non réveil des morts, elle s’explique : au Moyen-Âge, les suppliciés et autres brigands étaient ensevelis dans des fosses communes. Le fait de les déterrer, pour une quelconque raison, portait malheur. Le premier Germain, quand il acheta cette ferme, le savait-il ? Peut-être, peut-être…
*****
Au fait, et la partie de boules ? Naturellement, elle reprit dans la bonne humeur. Ce furent les Grandes-Gueules du haut qui gagnèrent le concours. Oui, mesdames et messieurs, cinq parties sur six ! Cette année là, ils avaient un atout secret : un jeune de dix huit ans qui tirait aussi bien que le Marcel d’en bas. Je peux vous assurer que ce fut un sacré spectacle en technicolor et techni-sonore comme on n’en voit plus ! Té ! Vous voulez que je vous dise ? Les parties de pétanque avec Pagnol, Bourvil et Fernandel, pffft, de la gnognote !
Le soir, durant le banquet qui suivit cet exploit, le Paulo d’en haut expliquait cette victoire d’une façon, comment dire, bien méridionale : «Ouais, on leur a laissé gagner une partie, car peuchère, aux Bravaches du bas, même fanfarons comme ils sont, on allait pas leur faire fanny sur un tel concours. Les pôvres, tu les vois tirer leur honte toutes leurs vies ? Une petite fanny sur une partie ordinaire, oui, avec plaisir. Mais, là, une fanny pour ce concours ? Non, franchement, ça ne se fait pas. Ils l’ont gagné une fois le concours, nous aussi. Ainsi, l’honneur de tout le monde est sauf. Et, l’année prochaine, on remet ça !»